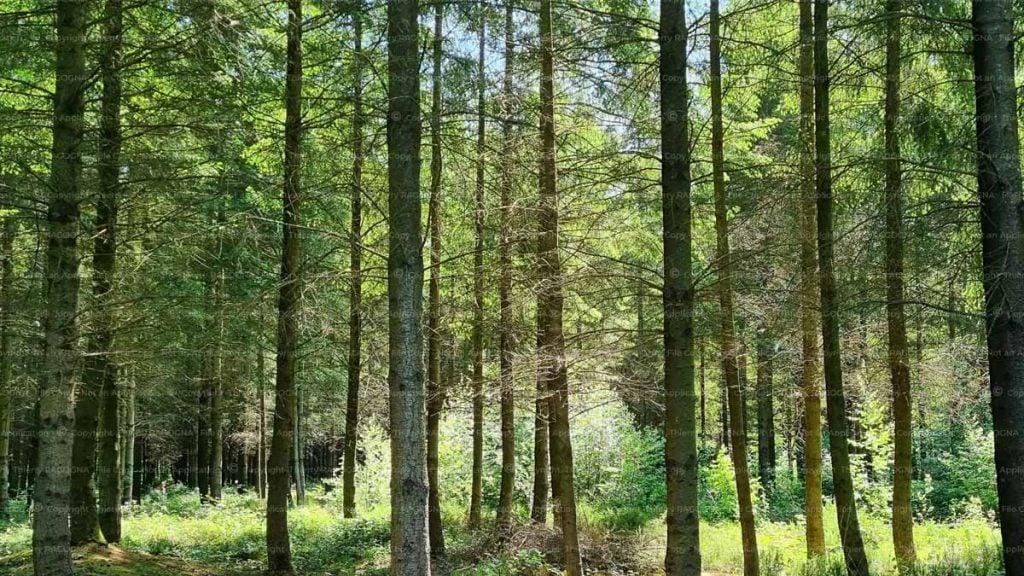L’occupation illégale change d’échelle et brouille les repères. Des forêts, des péniches et même des piscines deviennent des cibles, tandis que des propriétaires encaissent les coûts et l’impuissance. Les autorités interviennent tard, parfois pas du tout. Le phénomène gagne tout le pays, et les squatteurs exploitent chaque faille : terrains isolés, accès discrets, règles mal adaptées. À Paris, en Ille-et-Vilaine et à La Rochelle, des cas récents l’illustrent.
Forêts et champs privés, nouvelle cible des squatteurs
Selon maison-travaux.fr, les intrusions migrent vers des propriétés isolées. Elles s’organisent vite, hors de vue. Ces squatteurs arrivent de nuit, s’installent sans autorisation, puis disparaissent en laissant déchets, clôtures arrachées et ornières. Les victimes réparent, prouvent, recommencent. Les démarches restent lentes et fragmentées malgré l’urgence ressentie sur le terrain.
En Ille-et-Vilaine, Alain a vu son champ envahi cinq fois. Des rave parties sauvages attirent « deux à trois mille personnes ». Elles débarquent, montent du son, et s’éclipsent. Les dégâts atteignent des milliers d’euros, parfois sur des cultures. Les plaintes butent sur l’absence de témoins et les priorités locales.
Le squat de forêt demeure peu médiatisé, pourtant il progresse. Les terrains non bâtis échappent au contrôle quotidien. Les intrusions passent et les preuves manquent, si bien que les dossiers se classent. L’isolement aggrave tout: peu de surveillance, rares images, identifications difficiles, coûts qui s’additionnent.
Péniches et plaisance, quand les squatteurs frappent au fil de l’eau
Les ports de plaisance deviennent vulnérables. Les squatteurs ciblent des bateaux faciles d’accès, parfois laissés quelques heures. À Paris, au port de l’Arsenal, des propriétaires subissent des intrusions répétées. Gérard, installé depuis quinze ans, a vu son bateau brûler. « Vers cinq heures, quelqu’un a vu de la fumée sortir du bateau, et j’ai été prévenu. »
La nuit, des groupes s’invitent pour finir la fête. Un riverain évoque « la java », l’alcool, des sols tachés. Les contrôles restent limités le long des quais; on saute de ponton, on force une trappe, on teste une amarre. Les délais d’intervention et l’identification compliquent la suite judiciaire.
Face à la tension, des villes renforcent la dissuasion. À La Rochelle, un PC Sécurité surveille les accès. La mesure apaise, sans suffire. Les plaisanciers ajoutent cadenas, détecteurs et éclairages, documentent les dommages, centralisent les témoignages et recherchent des appuis juridiques adaptés.
Piscines, campings et un droit qui peine à suivre
L’usage non autorisé de piscines privées ou de bassins de campings se banalise. Les intrusions s’effectuent en journée, parfois en groupe, parfois filmées. Des risques sanitaires s’ajoutent aux atteintes à la propriété. Ici encore, les squatteurs profitent du manque de surveillance et des entrées latérales peu sécurisées.
La loi anti-squat prévoit des peines lourdes : trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Encore faut-il identifier les responsables. Selon Maître Pauline Declerck, avocate en droit immobilier, ces infractions peuvent relever de la violation de domicile. La difficulté consiste à obtenir l’identité des occupants temporaires. Sans identité, les poursuites s’effritent.
Sur les terrains non bâtis, l’application du droit se complique. L’absence de témoins et de vidéosurveillance bloque les enquêtes. Les victimes payent, nettoient, clôturent. Elles installent des caméras, signalent les faits et mutualisent les informations. La prévention progresse, mais le vide opérationnel expose encore les zones sensibles.
Protéger les accès et documenter, agir vite et ensemble
Le phénomène s’étend et touche des propriétaires très différents. Pour limiter l’impact, il faut signaler tôt, centraliser les preuves et coopérer avec le voisinage. Les ports, les campings et les zones forestières doivent renforcer les accès, éclairer, et tracer les passages. Tant que l’identification restera difficile, les squatteurs chercheront les angles morts. Des réponses coordonnées peuvent, elles, réduire durablement les risques.